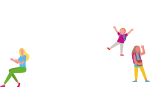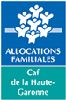Journée de rencontre autour du Cinéma et de l'Education à l'Image
Rendez-vous le jeudi 16 octobre de 10h à 16h à la MJC d’Empalot
Brique Rouge 9 Rue Maria MOMBIOLA 31400 TOULOUSE
Première rencontre
Les acteurs :
- La Cinémathèque de Toulouse et le réseau des MJC
- Cinéfol 31
- Cinéphilae
- La Trame
- Les Vidéophages
- J'Ouvre l'œil
Une initiative stimulée par Maria Fernanda HIGUERA, volontaire en service civique à la Fédération départementale des MJC de Haute-Garonne.
Jeunes spectateurs, jeunes acteurs : cinéma et construction de la citoyenneté
Le cinéma au sein des MJC ne se réduit pas à une activité simplement inscrite dans l’agenda, mais constitue une expérience à partager. Le cinéma est un langage commun qui rapproche les générations. Pour les jeunes, il ouvre un chemin vers la culture et vers le monde. Dans le cas des MJC, il existe différents formats à travers lesquels se vit l’expérience de regarder un film. Le ciné-débat, pratique très répandue, illustre parfaitement une dynamique qui engage directement une posture active dans les processus symboliques de la conversation générée après une projection. Il crée un espace de partage où les perceptions individuelles rencontrent des significations collectives. Les thèmes abordés par l’ouvrage, porteurs de résonances sociales, culturelles ou personnelles, deviennent matière à débat. Ce débat, animé par la parole de chacune et chacun, offre la possibilité de confronter des points de vue, de construire une interprétation commune et, en fin de compte, d’être un spectateur actif dans les processus de signification de la réalité.
Le spectateur actif partage certaines qualités avec celles du citoyen dans sa dimension la plus vivante : la participation active, l’écoute réciproque et la recherche collective de sens.
Dans la perspective de l’éducation populaire, le cinéma agit comme un véritable outil de citoyenneté : il encourage l’esprit critique, nourrit le dialogue et offre aux jeunes la possibilité de se découvrir à la fois spectateurs attentifs et acteurs engagés. On peut y observer plusieurs formes de superposition entre le rôle de spectateur et celui de citoyen. La première est l’exercice de la remise en question : interroger les représentations proposées à l’écran, comprendre les choix du réalisateur et envisager d’autres manières de percevoir ces représentations. Le spectateur devient alors un citoyen qui apprend à analyser, à douter, à chercher du sens au-delà de ce qui lui est montré.
La MJC devient ainsi une véritable agora, un lieu d’accompagnement et d’impulsion de tels processus. La notion de citoyenneté est profondément inscrite dans les pratiques de l’éducation populaire, et l’expérience cinématographique en constitue une illustration particulièrement féconde.
Pourquoi le cinéma dans une MJC ?
Au fil de mes entretiens, visites et conversations, une idée revenait avec insistance : ce qui distingue les MJC, c’est avant tout la possibilité de la rencontre. La rencontre ne se limite pas à l’expérience collective de regarder un film ensemble ; elle inclut aussi tous les sous-textes qui naissent autour de cette expérience : le tissage de conversations, la découverte de nouvelles personnes, la possibilité de prendre la parole en public, de partager une opinion ou de proposer une discussion. C’est là l’une des particularités des MJC qui projettent du cinéma : elles offrent un espace qui nourrit non seulement le développement du spectateur, mais aussi celui de l’individu dans sa relation à l’autre.
Un point essentiel réside dans le fait que, dans les MJC, l’expérience de spectateur ne s’enseigne pas, elle s’accompagne. Cet accompagnement dépasse la simple écoute d’une idée : il participe à la construction de la personne elle-même. Les MJC s’inscrivent ainsi dans une philosophie de l’auteur-acteur, qui valorise l’accompagnement des lectures de la réalité et la reconnaissance de chaque participant en tant qu’individu doté d’une singularité propre, mais aussi d’un pouvoir d’agir et de réagir face à son environnement vivant. Le cinéma devient alors un support privilégié pour ce processus : il ouvre un espace où chacun peut éprouver sa sensibilité, confronter ses perceptions à celles des autres et expérimenter la citoyenneté dans le partage et le dialogue.
Un exemple souvent évoqué est celui des documentaires ancrés dans le territoire : lorsqu’un film aborde des thèmes locaux — l’histoire d’un quartier, les enjeux environnementaux ou encore la vie associative — la projection se transforme en catalyseur de parole. Les habitants peuvent y retrouver des fragments de leur propre réalité, les comparer à d’autres expériences et, surtout, prendre la parole dans un cadre collectif. Ce moment de débat devient alors bien plus qu’une discussion sur un film : il constitue un exercice de citoyenneté, où l’expression individuelle se mêle à la construction vécue ensemble d’un sens commun.
Maria Fernanda HIGUERA, volontaire en service civique à la Fédération départementale des MJC de Haute-Garonne.